|
Notes de cours...
Unité 1
Introduction à l'évolution
La vie sur la Terre évolue depuis environ 3,5 - 4,0 milliards d’années
et on estime que 99% de toutes les espèces qui y ont vécu sont éteintes. Depuis
leur origine, la survie des organismes vivants est continuellement menacée par
des problèmes dans leur environnement. Parmi la multitude de formes de vie qui
existent maintenant, plusieurs espèces sont différentes les unes des autres et
les individus d’une même espèce présentent également certaines variations. Bref,
la diversité et l’environnement jouent un rôle important dans l’évolution.
|
L’évolution
est le résultat du changement graduel des caractéristiques
(génétiques) d’une population au fil des générations. |
-
L'adaptation des populations
Les adaptations d'une population à son environnement sont le
résultat de l'évolution d'une espèce depuis son origine. Une adaptation est une structure, un comportement
spécifique ou une caractéristique physiologique qui facilite la survie d’un
organisme et qui lui permet de se reproduire dans son milieu.
Une adaptation est donc le résultat d’un ensemble de
changements graduels qui surviennent au fil du temps et qui sont transmis à la
génération suivante. Ces adaptations peuvent être très simples à l’origine et
devenir très complexes.
Voici
différents mécanismes d’adaptation simples et complexes:

Biologie 12 (p.334)
-
L'odorat extraordinaire du requin
lui donne un avantage comme prédateur;
-
La forme du bec d'un pic lui
permet d'exploiter des sources de nourritures spécifiques;
-
Le pétoncle possède des yeux
simples (ocelles) sensibles à la lumière et au mouvement, mais
incapables de voir les images;
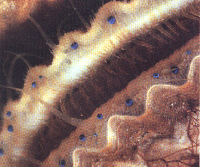
Biologie 12 (p.393)

Biologie 12 (p.393)
-
Les
types d'adaptation
|
Types
d’adaptation
|
Caractéristiques |
Exemples |
|
Structurale |
Adaptations anatomiques ou morphologiques. Elles touchent la forme
ou l’arrangement de caractères particuliers, ainsi que le
mimétisme*. |
Forme des nageoires chez les poissons; Pelage de certains animaux. |
|
Physiologique |
Adaptations associées aux fonctions des organismes. |
Enzymes qui inactivent la pénicilline chez certaines bactéries;
Toxines sécrétées par certaines plantes. |
|
Comportementale |
Adaptations reliées à la façon dont les organismes réagissent à leur
environnement. |
L’orientation des feuilles d’une plante vers la lumière
(phototropisme); Cri d’alerte pour avertir la meute. |
Exercice 1.1B: Les adaptations
* Notes complémentaires
Le
mimétisme se traduit par la capacité de certains organismes à ressembler
(d'un point de vue morphologique), soit à des éléments de leur milieu, soit à
d'autres organismes.
|
Formes de mimétisme |
|
Mimétisme |
Description |
Exemples |
|
Camouflage
(homochromie = couleur et
homotypie = forme) |
Adopter une coloration cryptique qui se confond avec des objets
inanimés de
l’environnement. |
Animaux marins dont les couleurs se confondent à celles des récifs. |
|
Coloration d’avertissement
(aposématique) |
Arborer des couleurs criardes de mise en garde contre un réel
danger. |
La peau du Dendrobate fraise (grenouille) (Dendrobates pumilio)
produit des toxines et les prédateurs apprennent à fuir les motifs
voyants de sa peau. |
|
Mimétisme Müllérien |
Lorsque deux espèces également dangereuses présentent des
colorations aposématiques |
L’abeille nomade (Nomada graenicheri) et la guêpe de l’est (Vespula
maculifrons) possèdent toutes les deux un dard qui libère des
toxines. Leur couleur et leur apparence semblables semblent
avantager les deux espèces.
Le papillon vice-roi (Basalarchia
archippus) possède une coloration semblable à celle du papillon Monarque (Danaus
plexippus). La ressemblance de ces deux espèces nocives
est alors avantageuse autant pour l'une que pour l'autre.
|
|
Mimétisme batésien
(travestissement) |
Une espèce (inoffensive) qui se fait passer pour une autre espèce
(nocive) en prenant son apparence ou en imitant un de ses
comportements. |
La couleuvre faux-corail (Lampropeltis triangulum),
inoffensive, mime les motifs de couleur du serpent corail (Micrurus
tener), venimeux.
Les lucioles femelles (Luciola sp.) émettent des
signaux lumineux qui ont pour fonction d'attirer les mâles de
l'espèce en vue de l'accouplement. Les femelles d'une autre espèce,
les photuris (Photuris sp.) imitent les signaux lumineux des
lucioles, ce qui attire les mâles des lucioles, lesquels seront
dévorés. |
-
La sélection naturelle et artificielle
L'évolution est généralement le résultat d'un changement
dans le pool génique d'une population.
|
Un pool génique correspond à
l’ensemble de tous les gènes présents dans une population à un
moment donné. |

-
La sélection naturelle est le processus de
changement selon lequel les individus les mieux adaptés à un
environnement particulier survivent et transmettent leurs caractères
à leurs descendants (ex: bactéries résistantes). Elle est
circonstancielle, aléatoire et correctrice.
La sélection naturelle:
-
est circonstancielle, c’est-à-dire qu’elle
n’anticipe pas les changements de l’environnement.
-
agit par hasard sur les caractères inutiles à
la survie d’une population un jour et qui l’aide à survivre un autre.
-
joue un rôle de correctrice mais ne travaille
qu’avec ce qui est déjà présent dans la population.
-
a lieu s’il existe une grande diversité au sein
d’une espèce.
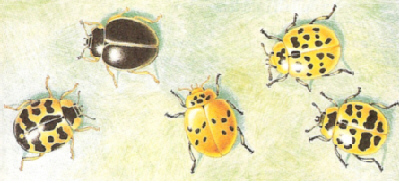
Coccinelles asiatiques (Propylaea quatuordecimpunctata)
Biologie
[2e
Éd.] (p.473)

Évolution de la résistance aux insecticides
Biologie
[2e
Éd.] (p.475)
-
La sélection artificielle consiste plutôt
à croiser des individus afin de favoriser l’apparition de caractères
recherchés dans la génération suivante. (ex: croisement de certaines
races de chiens). Ce mode de sélection peut toutefois perpétuer des
caractères indésirables.
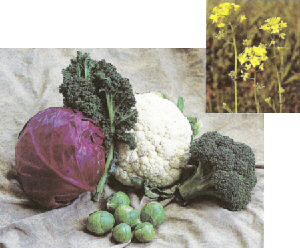
Le chou, le chou frisé, le chou-rave, le chou de Bruxelles,
le chou-fleur et le brocoli sont
tous issus artificiellement
à partir de la Moutarde sauvage (Brassica
arvensis).
Biologie
[2e
Éd.]
(p.474)
|
Dans la sélection naturelle,
l’environnement joue le rôle que l’humain joue dans la
sélection artificielle. |
Exercice 1.1C: Phalène du
bouleau
Contact | Carte du site

|

|
