|
Notes de cours...
Unité 2
Les théories de l'évolution
Autrefois, plusieurs pensaient que les espèces
possédaient un ensemble fixe de caractères et que les
populations ne changeaient pas au fil
des temps. Suite à plusieurs observations, les scientifiques réfutèrent cette
croyance et démontrèrent que les populations changent de façon graduelle avec
le temps et que certaines espèces font place à de nouvelles
espèces. Les travaux de Jean-Batiste de Lamarck et de Charles Darwin ont dominé
l’étude de l’évolution pendant plusieurs années.
-
Les théories de l'évolution
-
La théorie de Lamarck (Jean-Batiste)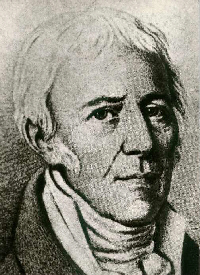
C’est en 1809 que Jean-Batiste de Lamarck (1744-1829),
naturaliste français, publie sa théorie pour expliquer la grande variété
qu’il observait chez les organismes. Selon ses observations, les
espèces peuvent changer (évoluer) au fil des générations en s'adaptant à
leur environnement. Les organismes sont d'abord très simples et
deviennent graduellement de plus en plus complexes, atteignant finalement
une forme de perfection. Selon lui, les espèces deviennent de mieux en
mieux adaptés à leur environnement.
La théorie (transformisme) de Lamarck est fondée
sur deux principes:
|
1.
L'usage et le non usage: les parties qu'un organisme utilise
davantage se développent et se renforcent alors que celles peu utilisées
s'atrophient (ex: le cou de la girafe vs les yeux de la taupe).
2. L'hérédité des
caractères acquis: les modifications acquises par un organisme
peuvent être transmises à ses descendants (ex: le long cou de la girafe). |
En résumé, Lamarck croyait que les organismes modifiaient
leur comportement en fonction des changements dans l'environnement.
Ainsi, les organismes pouvaient acquérir des traits au cours de leur vie et
transmettre ces caractères acquis à leurs descendants.
Lamarck appuya ses
conclusions
en utilisant la girafe comme exemple. Selon lui, les premières girafes
n’avaient pas un long cou ni de longues pattes antérieures.
Ce n’est qu’après avoir mangé toute l’herbe et toutes les feuilles des
branches basses que les girafes ont dû s’étirer le cou pour atteindre les
branches plus hautes. Leur cou s’est alors allongé de génération en
génération et elles ont transmis ce caractère acquis à leurs rejetons qui
ont maintenant tous le cou long.
Bien que le mécanisme d'évolution de Lamarck ait été
rejeté, il n'en demeure pas moins que ses observations perspicaces ont suscité
beaucoup de réflexions et de discussions, en plus de démontrer que l'évolution
est le résultat des adaptations graduelles des organismes à leur environnement.
La théorie de Darwin (Charles)
C’est en décembre 1831 que
Charles Darwin (1809-1882), un naturaliste anglais, était invité à
s’embarquer à bord du Beagle lors d’une exploration en Amérique du
Sud. À 22 ans, il était chargé de faire la liste des plantes et des animaux
qu’il observait au cours du voyage.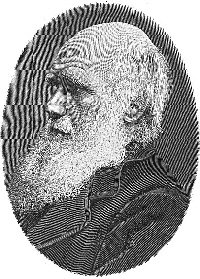
De retour en Angleterre, au
terme d’un voyage de cinq ans, il étudia ses collections, réfléchit à ses
observations et poursuivit ses recherches. Darwin remarqua qu’il n’y avait
jamais deux individus identiques dans une population. Il s’aperçut que les
caractères variaient d’un organisme à l’autre et que ce sont ces variantes
qui sont transmises aux générations suivantes plutôt que les caractères
acquis. Graduellement, sa célèbre théorie de la sélection naturelle allait
naître.
Darwin conclut que la
diversité d’adaptation qui existe chez les organismes vivants repose sur un
processus naturel de modifications auprès des descendants d’une
espèce. Selon cette idée, les membres de chaque génération présentent de
légères différences par rapport à ceux précédents et les adaptations
s’accumulent sur une longue période de temps, produisant ainsi des
transformations majeures.

Trajet du Beagle
Biologie 12 (p.342)
Finalement, la théorie de l’évolution de
Darwin (1859) se résume ainsi:
|
1. Il y a des variations au sein des
populations.
2. Certaines variations sont plus favorables
que d’autres à la survie et à la reproduction. 3. Les organismes produisent plus de
descendants
qu’il ne peut en survivre (compétition). 4. Avec le temps, les populations comptent
une plus grande proportion d’organismes les mieux adaptés. |
-
Voici un résumé du raisonnement de Darwin:
Observation 1: Une
population a le potentiel de grandir très rapidement car les organismes
peuvent produire plus de descendants que nécessaire pour simplement remplacer
les deux parents. Cependant, le nombre d’individus dans une population tend à
demeurer relativement stable avec le temps.
Conclusion 1:
Tous les organismes nés ne survivent pas. Les organismes d’une population sont
donc en compétition entre eux pour leur survie.
Observation 2:
Chaque membre d’une population diffère des autres au niveau de ses habiletés à
obtenir des ressources, de résister aux conditions extrêmes du milieu ou de
s’échapper des prédateurs.
Conclusion 2:
Les différences entre les membres d’une population aident à déterminer
lesquels pourront survivre et se reproduire avec succès, et ainsi produire un
plus grand nombre de descendants. Ces traits « supérieurs » qui leur donnent une
meilleure valeur d’adaptation à leur environnement est le résultat de
la sélection naturelle.
Observation 3: Certaines variations
bénéfiques pour la survie et la reproduction sont héréditaires et transmises
des parents aux descendants.
Conclusion 3: Puisque les individus
les mieux adaptés produisent plus de descendants, les gènes de ces individus
seront transmis à un plus grand nombre d’individus dans les générations
suivantes. Ces traits avantageux modifient alors la proportion du pool génique
de la population, résultat de la sélection naturelle.
-
Les
types d'évolution
-
L'évolution divergente
L’évolution divergente
est caractérisée par des espèces qui proviennent d’un ancêtre commun mais
qui divergent ou deviennent de plus en plus distinctes. Ce type d’évolution
a lieu lorsque des populations changent à mesure qu’elles s’adaptent à leur
milieu respectif. Avec le temps, ces populations se ressemblent de moins en
moins et finissent par former deux espèces différentes.
Exemple:
Les pinsons (géospizes) des îles Galapagos proviennent tous d’un ancêtre
commun. Cependant, puisque certains ont migré dans des milieux différents,
ils ont évolué différemment selon leur environnement.

Géospizes - ancêtre
-
L'évolution convergente
L’évolution convergente est caractérisée par des espèces
non apparentées qui possèdent des caractères semblables. Ce mode d’évolution
s’observe quand deux espèces non apparentées sont adaptées à des milieux
similaires.
Exemple: Les oiseaux et les chauves-souris ont évolué de
façon indépendante et à différentes époques. Toutefois, ces organismes sont
exposés au même environnement, l’air. Puisqu’ils n’ont pas d’ancêtre commun,
ils ont développé des ailes très différentes.
|
 |
 |
|
Colibri (Chordé) |
Sphynx-colibri (Arthropode) |
|
Le colibri et le sphynx-colibri appartiennent à des embranchements différents. Leurs
ressemblances est le résultat de l’évolution convergente. |
-
Coévolution
Bien que la coévolution puisse prendre plusieurs formes*,
elle est généralement caractérisée par des organismes
étroitement liés les uns aux autres et qui ont chacun évolué sous l'influence
de l'autre.
Exemple: La plupart des plantes dépendent des animaux et
des insectes pour la dissémination de leur pollen. Les plantes ont élaboré des
stratégies pour attirer les insectes et les animaux qui se nourrissent de
nectar
|
Organisme en coévolution avec les plantes |
Adaptation de la plante |
Avantages |
|
Oiseaux |
Pétales rouge vif |
Attire les oiseaux
et non les
insectes parce que ces derniers ne perçoivent pas les couleurs. |
| Inodore |
Les oiseaux ont un
mauvais odorat. |
|
Nectar situé dans
de longs tubes larges |
Convient au long
bec rigide des oiseaux. |
|
Abeilles |
Possède un léger parfum sucré |
L'insecte possède un odorat développé. |
| Fleurs jaunes, bleues |
Contrairement au rouge, ces couleurs sont
éclatantes. |
*Notes complémentaires
Plusieurs
populations résultent d'une coévolution dite en symbiose, c'est-à-dire que
deux espèces différentes entretiennent des relations en vivant en contact
direct. Bien que certains biologistes la définissent différemment, de façon générale, la symbiose peut avoir des effets bénéfiques,
nuisibles ou neutres sur les espèces en relation.
La symbiose comprend le mutualisme, le commensalisme et le parasitisme.
Le mutualisme (+/+) étant une relation qui profite aux deux
organismes (ex: digestion de la cellulose par les microorganismes des
intestins des termites et des ruminants; relation entre les acacias (plante)
et les fourmis porte-aiguillon qui se nourrissent des glucides produits par la
plante tout en attaquant les prédateurs qui s’approchent des acacias). Le
commensalisme (+/0) est plutôt le résultat d'une interaction avantageuse pour
l'une des deux espèces, sans
pour autant nuire ou aider l'autre de façon significative (ex: Les algues qui croissent sur les carapaces des
tortues assurent leur survie mais nuisent aux tortues; Les balanes (crustacés)
qui s'attachent aux baleines). Finalement, le parasitisme
(+/-) représente la relation d'un parasite qui se nourrit au dépens de son hôte, lui
nuisant ainsi sans nécessairement le tuer (ex: le ténia (ver solitaire) à l'intérieur
de l'intestin d'un organisme ou les pucerons
à la surface d'un arbuste).
La
coévolution peut également avoir lieu entre un prédateur et sa proie. Par
exemple, le guépard aura plus de chances de capturer la gazelle la moins
rapide d'un groupe. Sur plusieurs générations, celles les plus rapides
(dans le présent cas) pourront survivre et favoriser le développement d'une
population de gazelles de plus en plus rapides. À son tour, le guépard sera
confronté à une pression sélective face ce moyen de défense (i.e. rapidité)
de la gazelle.
Contact |
Carte du site

|

|
